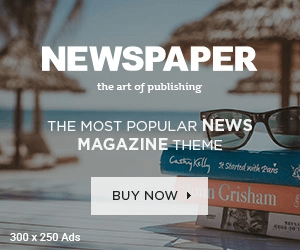Depuis son entrée en fonction, le président américain Donald Trump a cherché à honorer l’une de ses principales promesses de campagne : mettre fin à la guerre en Ukraine. Cependant, près de deux mois plus tard, les avancées concrètes se font attendre. Cet article retrace les étapes clés des négociations et les défis rencontrés.
Les promesses de campagne face à la réalité
Donald Trump avait assuré pendant sa campagne qu’il mettrait fin à la guerre en Ukraine dans les 24 heures suivant son investiture. Pourtant, deux mois après son entrée en fonction, aucun accord significatif n’a été trouvé. Le président a depuis revu ses ambitions, évoquant d’abord un délai de six mois, puis admettant que son engagement initial était en partie sarcastique.
Les négociations en cours
Les États-Unis ont engagé des discussions séparées avec l’Ukraine et la Russie, mais les progrès sont lents. La Russie, bien qu’en principe favorable à un cessez-le-feu, a multiplié les conditions, rendant tout accord difficile. Trump, de son côté, a clairement indiqué que le soutien militaire américain à l’Ukraine dépendrait de son adhésion à une approche ferme.
Une chronologie des événements
De l’investiture de Trump en janvier aux récentes attaques russes sur Odesa en mars, chaque étape a été marquée par des espoirs déçus et des tensions croissantes. Les rencontres entre dirigeants, les sommets d’urgence et les déclarations publiques illustrent la complexité des négociations et les divergences profondes entre les parties.
L’impasse actuelle
Malgré quelques avancées, comme l’accord de principe sur un cessez-le-feu en mars, les demandes russes ont rapidement rendu cet accord inapplicable. Les récentes discussions en Arabie saoudite n’ont pas permis de débloquer la situation, laissant l’Ukraine et ses alliés dans l’attente d’une solution durable.